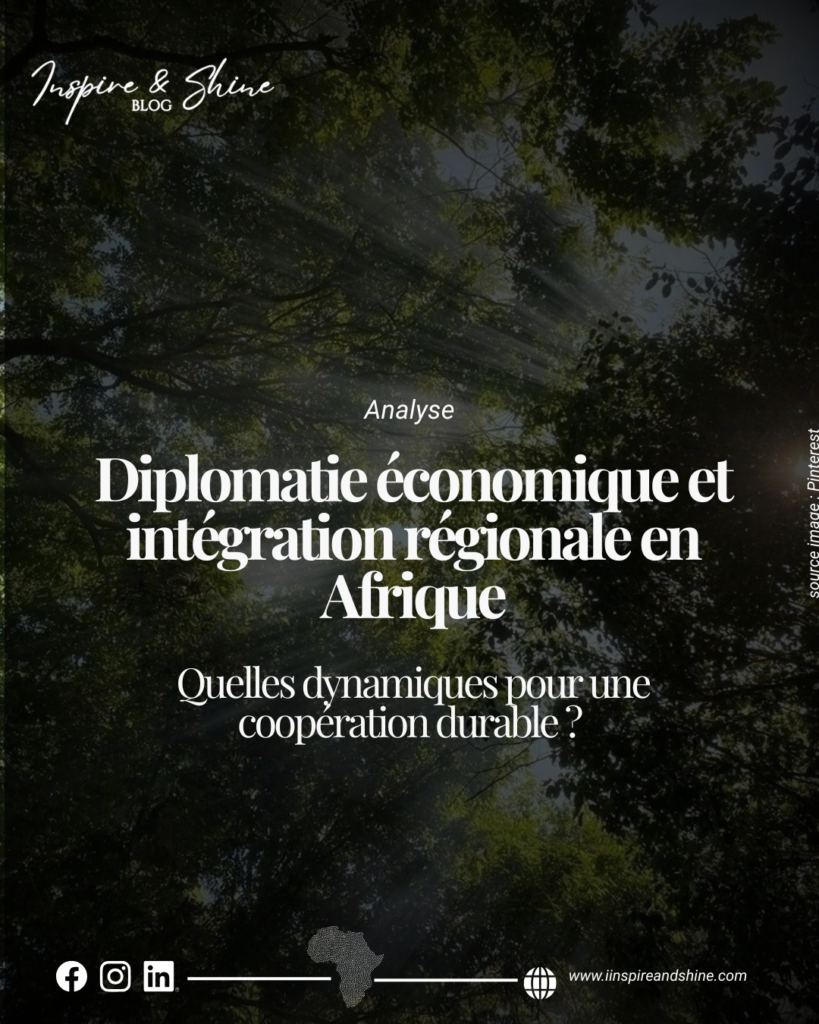Analyse avec Daouda Amadou KASSE

Dans un contexte mondial marqué par l’instabilité, la construction d’un monde juste, fondé sur des institutions solides, demeure une priorité incontournable. L’Objectif de Développement Durable 16 (ODD 16), qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, garantir l’accès à la justice pour tous et renforcer l’efficacité des institutions, s’impose comme un levier essentiel pour bâtir un avenir équitable et résilient.
Alors que l’Afrique traverse des transformations majeures sur les plans démographique, économique et technologique, la mise en œuvre de l’ODD 16 devient un impératif stratégique pour prévenir les crises, consolider la stabilité et favoriser un développement durable.
Cette semaine, dans la rubrique Analyse, nous mettons en lumière le thème :
« Paix, justice et institutions fortes : l’ODD 16 au cœur des transformations en Afrique ».
Pour enrichir cette réflexion, nous accueillons un contributeur originaire du Sénégal.
Son nom: Daouda Amadou KASSE.

Analyse
Cher invité, bienvenue sur InspireAndShine, avant tout propos qui est Daouda Amadou KASSE? Daouda Amadou KASSE est un jeune professionnel sénégalais engagé dans la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix en Afrique. Ma formation académique inclut un Master en Paix, Sécurité et Développement (Université Numérique Cheikh Hamidou Kane), complété par des certifications spécialisées en droits humains (École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye) et en climat-paix (United Nations Institute for Training and Research). Mon parcours professionnel reflète un engagement concret : en tant qu’Ambassadeur de Programme pour l’AU-EU Youth Voices Lab et Ambassadeur de la Paix Positive en 2024 (Institute pour l’Économie et la Paix), je contribue au dialogue intercontinental et à la résilience communautaire. Mon expérience à la CEDEAO comme Associé de Programme et à la Mission d’Observation Électorale de l’UE au Sénégal souligne mon implication dans la gouvernance ouest-africaine et les processus démocratiques.
Actuellement Vice-président de Green Generation (UNICEF) et membre du réseau Youth4Peace Sénégal, j’intègre systématiquement les enjeux climatiques et la participation citoyenne des jeunes dans mes action. Certifié du programme PNUD en leadership et gouvernance politique, mon approche relie l’analyse des conflits, la prévention de l’extrémisme et la promotion d’une gouvernance inclusive, avec une attention particulière aux dynamiques sahélo-sénégalaises.
Que vous inspire le thème sujet à notre analyse ?
Ce thème est fondamental et urgent. L’OOD 16 n’est pas un objectif pamis d’autres ; c’est le catalyseur qui permet la réalisation de tous les autres objectifs de développement durable. Sans paix, dans accès à la justice et sans institutions redevables, les investissements dans la santé, l’éducation ou les infrastructures sont fragiles et peuvent être anéantis par un conflit ou une corruption systémique. C’est donc l’épine dorsale de la transformation africaine.
Selon vous, pourquoi l’ODD 16 est-il essentiel pour bâtir des sociétés africaines plus résilientes et inclusives ?
La résilience, c’est la capacité d’une société à absorber les chocs et à se reconstruire. L’ODD 16 construit cette résilience en se créant un contrat social fort où les citoyens font confiance à leurs institutions pour les protéger et garantir leurs droits. Par exemples, des institutions judiciaires indépendantes, comme la Cour Justice de la CEDEAO, offrent aux citoyens un recours contre les abus, renforçant ainsi l’Etat de droit. L’inclusivité est servie par une participation citoyenne effective, notamment des jeunes, des femmes et des personnes en situation d’handicap, aux processus décisionnels ce qui assure que les politiques publiques répondent aux besoins réels de toute la population.
Les institutions africaines sont-elles suffisamment outillées pour accompagner les transitions sociales, économiques et environnementales ?
Je dirais que c’est nuancé. Des progrès significatifs ont été réalisés, mais des défis persistent. Des institutions comme L’Union Africaine et ses mécanismes, l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) fournissent un cadre solide. Cependant, au niveau national, de nombreuses institutions souffrent d’un manque chronique de ressources financières et humaines, de la politisation et de la faible numérisation des services. « Le rapport 2023 de Mo Ibrahim » sur la Gouvernance en Afrique note des progrès dans le développement humain, mais une stagnation préoccupante en matière de participation, droits et inclusion. Pour les transitions complexes comme le climat, le défi est de bâtir des capacités techniques spécialisées et intersectorielles.
Comment la justice transitionnelle peut-elle favoriser la reconstruction des liens sociaux dans les communautés affectées par des crises ?
La justice transitionnelle va au-delà de la punition ; elle cherche à guérir. Elle combine vérité, réparation et réconciliation pour restaurer la confiance. Le modèle du Rwanda, avec les « Tribunaux Gacaca », est souvent cité. Bien qu’imparfait, il a permis de juger un nombre colossal de crimes en impliquant la communauté, favorisant un frome de catharsis collective. Au Mali, les dialogues intercommunautaires soutenus par des organisations comme le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) depuis 2017 ont été essentiels pour apaiser les tensions entre agriculteurs et éleveurs. La clé est une approche contextuelle, qui mêle mécanismes judiciaires et traditions locales médiation.
Comment les crises sécuritaires affectent-elles la capacité des institutions à garantir les services essentiels aux populations ?
Les crises sécuritaires créent un cercle vicieux. Elles détournent les ressources des budgets sociaux (santé, éducation) vers les dépenses militaires. Selon un rapport de L’OCDE (2022), les dépenses militaires dans le sahel ont explosé, au détriment des services sociaux. De plus, l’insécurité détruit les infrastructures (écoles, centres de santé) et déplace les populations et le personnel qualifié, comme on le voit dans le bassin du Lac Tchad avec Boko Haram. L’institution elle-même est affaiblie, perd sa légitimité et sa capacité opérationnelle, creusant le sentiment d’abandon chez les citoyens.
Quels espaces et mécanismes permettent aux jeunes de contribuer concrètement au renforcement des institutions ?
Les jeunes ne sont pas seulement l’avenir, ils sont des acteurs du présent.
Il faut donc créer les parlements des jeunes et des conseils Nationaux de la jeunesse, comme le Sénégal, qui offre un canal de plaidoyer: Les Observatoires de la Dépense Publique où les jeunes, formés, traquent la corruption au niveau local. Il faut la participation des jeunes aux Missions D’Observation Électorale, comme je l’ai vécu avec UE, où les jeunes jouent un rôle crucial pour garantir la crédibilité des processus démocratiques. L’enjeu est que ces espaces soient dotés d’un pouvoir décisionnel réel et non simplement consultatif.
Les pratiques traditionnelles africaines de médiation peuvent-elles enrichir les approches modernes de résolution des conflits ?
Absolument. L’Afrique regorge de sagesses en matière de résolution des conflits, fondées sur la restauration de l’harmonie sociale plutôt que sur la victoire d’une partie. Le « Bushingantahe » au Burundi ou le « Xeer » en Somalie sont des systèmes de justice coutumière qui fonctionnent depuis des siècles. L’erreur serait de les opposer aux systèmes modernes. La solution est l’hybridation. Au Nord-Kivu (RDC), des programmes soutenus par des ONG internationales créent des cadres de collaboration entre les chefs traditionnels et les tribunaux étatiques pour traiter les litiges fonciers, combinant la légitimité locale de l’un et la force exécutoire de l’autre.
Comment garantir un accès équitable à la justice dans les zones rurales et marginalisées ?
C’est un défi majeur qui requiert une approche multidimensionnelle :
La justice mobile : Des tribunaux itinérants, comme ceux déployés au Kenya et en Ouganda, se déplacent dans les villages pour juger les affaires.
Le parajurisme : Former des membres de la communauté à conseiller sur les droits fondamentaux et les procédures simples. Le programme « Justice Pour Tous » du Ghana a formé des milliers de para-juristes, réduisant considérablement la surpopulation carcérale pour des petits délits.
La technologie : Utiliser la téléphonie mobile pour offrir des conseils juridiques à distance ou enregistrer des plaintes, une initiative prometteuse dans plusieurs pays.
Comment les médias et les réseaux sociaux peuvent-ils devenir des leviers de transparence et de mobilisation citoyenne ?
Les médias sont déjà des leviers puissants. Les médias d’investigation, comme Platform for the Protection of Whistleblowers in Africa (PPLAAF), exposent les scandales de corruption. Les réseaux sociaux permettent une surveillance citoyenne en temps réel : dénonciation de pots-de-vin, partage d’informations sur les ruptures de stocks de médicaments, mobilisation pour la redevabilité, comme le mouvement « BringBackOurGirls » au Nigeria. Cependant, le revers de la médaille est la désinformation. Il est donc crucial de renforcer l’éducation aux médias pour que les citoyens deviennent des consommateurs critiques de l’information.
Quels sont les freins à la mise en œuvre de politiques publiques inclusives et justes dans les sociétés africaines ?
Plusieurs freins se conjuguent :
La capture de l’État : Les élites politiques et économiques orientent les politiques à leur profit, au détriment de l’intérêt général.
La faible capacité statistique : Sans données fiables et désagrégées, il est impossible de concevoir des politiques ciblées et d’évaluer leur impact. Les efforts de l’Institut National de la Statistique dans des pays comme le Sénégal sont cruciaux.
La corruption : Elle détourne les ressources et sape la confiance.
Le clientélisme : Les politiques sont souvent conçues pour récompenser une base politique plutôt que de répondre à des besoins objectifs.
L’éducation civique et citoyenne est-elle suffisamment intégrée dans les systèmes éducatifs pour soutenir l’ODD 16 ?
Je dirais que, c’est encore très insuffisant. Trop souvent, l’éducation civique se résume à une matière théorique. Elle doit devenir pratique et expérientielle. Il s’agit d’enseigner les valeurs de tolérance, de redevabilité, et de participation active. Des initiatives comme le programme « Éducation à la Citoyenneté Mondiale » de l’UNESCO ou les Simulations de l’Union Africaine dans les universités sont excellentes. Il faut les généraliser et les intégrer dès le plus jeune âge pour construire une culture de la paix et de la bonne gouvernance.
Comment les partenariats internationaux peuvent-ils accompagner les dynamiques locales sans les orienter ?
La clé est l’alignement et l’appropriation. Les partenaires doivent s’aligner sur les priorités définies par les pays eux-mêmes, telles qu’exprimées dans leurs stratégies nationales de développement (ex : Vision Sénégal 2050), et non imposer leurs agendas. Ils doivent renforcer les capacités endogènes en travaillant avec et à travers les institutions locales, les OSC et les experts nationaux, plutôt que de mettre en place des systèmes parallèles. Le principe doit être : « Nothing about us, without us » (Rien sur nous, sans nous).
Quel lien unit le concept de paix durable à celui de justice sociale ?
Une paix durable est impossible sans justice sociale. Une paix qui se contenterait de l’absence de violence physique serait une paix négative, fragile. La paix positive, concept promu par l’Institute for Economics and Peace qui m’a nommé ambassadeur de la paix positive en 2024, implique l’accès à l’éducation, à la santé, à l’équité et à la justice. Lorsque des groupes entiers de la population sont exclus des opportunités économiques, marginalisés politiquement ou victimes de discriminations systémiques, cela crée un terreau fertile pour le ressentiment, l’extrémisme violent et la conflictualité. La justice sociale est le ciment de la paix durable.
Quel message fort peut-on porter aujourd’hui pour que l’ODD 16 devienne un moteur de transformation dans les sociétés africaines ?
Mon message est que l’ODD 16 est l’affaire de tous. Ce n’est pas un objectif technique réservé aux gouvernements et aux diplomates. Chaque citoyen est un acteur de la paix et de la justice. Chaque fois que nous refusons de payer un pot-de-vin, que nous participons à une élection, que nous défendons les droits d’un voisin ou que nous engageons un dialogue constructif, nous renforçons l’ODD 16. Investissons dans l’éducation à la citoyenneté, responsabilisons nos dirigeants et célébrons les héros ordinaires de l’intégrité. La transformation commence par des actions individuelles qui, collectivement, créent un changement systémique.
Un dernier mot ?
Je vous remercie pour cette opportunité d’échange. J’aimerais insister sur l’impératif de l’espoir et de l’action. Les défis sont immenses, mais l’Afrique regorge de solutions innovantes portées par sa jeunesse, sa société civile et ses leaders visionnaires. En faisant de l’ODD 16 notre boussole commune, nous pouvons construire des sociétés où la dignité, la justice et la paix ne sont pas des privilèges, mais une réalité pour tous. Continuons à inspirer et à briller. Merci.

L’ODD 16 s’impose comme un pilier stratégique de l’Agenda 2030. Sans paix, sans justice et sans institutions solides, les ambitions de développement durable restent fragiles et vulnérables aux crises. Les propos de Daouda rappellent une évidence : la gouvernance inclusive, la transparence et la participation citoyenne ne sont pas des options, mais des impératifs pour bâtir des sociétés africaines résilientes.
Dans un contexte global marqué par des tensions sécuritaires et des transitions économiques et sociales, l’urgence est de renforcer les institutions et de restaurer la confiance entre l’État et les citoyens. Cette transformation ne peut reposer uniquement sur les gouvernements : elle exige une mobilisation collective, des jeunes aux acteurs privés, en passant par la société civile et les partenaires internationaux. Faire de l’ODD 16 une priorité, c’est investir dans la stabilité, la justice et la dignité pour tous. C’est aussi reconnaître que la paix et la bonne gouvernance sont les conditions préalables à tout progrès durable.
Cher Daouda, InspireAndShine vous remercie chaleureusement pour votre contribution à cette analyse mais aussi et surtout pour votre engagement constant en faveur de la construction d’un monde meilleur.
Comme lui, vous aussi pouvez partager votre expertise sur des sujets avec pour coeur la transformation sociale et économique en Afrique. Pour cela, faites-nous parvenir votre biographie à l’adresse suivante : contact@iinspireandshine.com.
InspireAndShine
Pour tout savoir sur votre blog: Tout savoir sur InspireAndShine – InspireAndShine
A lire en Septembre sur InspireAndShine !