Enjeux stratégiques et solutions locales avec Louise IZERE

Peut-on être riche et manquer de pain sur la table?
À cette question, 100 % des personnes interrogées au cours d’une etude donnée, répondront sans hésiter : « Non! ». Et pourtant, dans bien des cas, la réponse peut bel et bien être l’affirmatif.
L’Afrique possède près de 60 % des terres arables non cultivées à l’échelle mondiale (1), ainsi que d’importantes réserves d’eau douce(2), des ressources minières stratégiques telles que l’or, le cobalt et le lithium, et une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, ce potentiel naturel contraste fortement avec les réalités socio-économiques du continent. Selon l’UNESCO, l’agriculture consomme environ 70 % des volumes d’eau douce prélevés dans le monde, tandis que 25 % de l’irrigation mondiale repose sur les eaux souterraines (3) une ressource cruciale dans les zones arides africaines.
Malgré ces atouts, l’Afrique fait face à une insécurité alimentaire croissante : en 2025, plus de 307 million de personnes souffrent de la faim, soit plus de 20 % de la population du continent (4). Le stress hydrique touche environ 250 millions d’Africains et pourrait entraîner le déplacement de 700 millions de personnes d’ici 2030 (5). En outre, quatre pays africains sur cinq ne disposent pas de ressources en eau gérées de manière durable. Qu’est-ce qui explique une telle contradiction? comment y remedier ?
Dans cette nouvelle analyse, avec Louise IZERE, spécialiste en coopération internationale, nous parlerons : « Eau, agriculture et climat en Afrique : enjeux stratégiques et solutions locales. »

Analyse
Chère Izere, bienvenue sur InspireAndShine. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduite à repenser le développement durable en Afrique?
Merci beaucoup de m’accueillir sur InspireAndShine, c’est un honneur pour moi. Mon parcours, je dirais qu’il est un peu atypique… mais il a toujours été guidé par une conviction très claire.
Je suis arrivée en France à 15 ans. Et déjà, à cet âge-là, je savais que je repartirais. Je savais que je voulais revenir sur le continent, mais pas les mains vides, avec des outils solides. J’ai donc fait un master en management de projets internationaux, avec une spécialisation en coopération internationale. Consciente que les diplômes, seuls, ne suffiraient pas, j’ai fait mes études en travaillant, dès le départ.
Pendant cinq ans, j’ai évolué dans le domaine de l’efficacité énergétique, auprès de deux entrepreneurs qui m’ont appris à penser un projet de A à Z , de l’idée jusqu’à la mise en œuvre. Une fois que je me suis sentie prête, j’ai sauté le pas. J’ai commencé à travailler (enfin) sur le continent, d’abord en Afrique de l’Ouest, puis en Afrique centrale, sur des projets dans les énergies renouvelables, les déchets, l’accès aux services de base, la valorisation des ressources locales… Et à chaque fois, j’ai beaucoup appris.
J’ai découvert la richesse des dynamiques locales, mais aussi ce qui, souvent, freine les projets de développement: il ne s’agit pas du manque d’idées ou d’argent, mais du manque d’ancrage humain.
Petit à petit, j’en suis venue à cette conviction: si on ne met pas l’humain au centre, on peut cocher toutes les cases du développement durable… sans jamais vraiment transformer les choses. Et aujourd’hui, c’est ce qui guide tout mon engagement.
Que vous inspire le thème « Eau, agriculture et climat en Afrique » dans le contexte actuel du développement durable? En quoi ce triptyque représente-t-il un enjeu stratégique pour l’avenir du continent?
Ce triptyque est pour moi, la colonne vertébrale du développement humain durable en Afrique. Quand on parle d’eau, d’agriculture et de climat, on parle de vie, de souveraineté, et de survie. L’eau, c’est la base. Sans accès durable à l’eau, il n’y a pas d’agriculture. Et sans agriculture résiliente, il n’y a pas de sécurité alimentaire, pas d’autonomie pour les communautés rurales, pas de stabilité sociale. Cependant aujourd’hui, le climat vient bouleverser tout cet équilibre.
Sécheresses, pluies imprévisibles, appauvrissement des sols… Et cela touche directement ceux qui dépendent de la terre pour vivre donc une grande majorité de la population africaine.
Ce triptyque est stratégique car il révèle tous les liens entre développement, justice climatique, souveraineté alimentaire, et dignité humaine. Il nous oblige à penser en systèmes, pas en silos. Et surtout, il nous montre que la solution ne viendra pas uniquement de technologies importées. Elle viendra aussi de notre capacité à valoriser les pratiques agricoles locales, à protéger les ressources, et à repenser les modèles de production et de distribution pour qu’ils soient adaptés aux réalités africaines.
Selon vous, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu’on aborde les questions de développement durable en Afrique?
L’erreur la plus courante, c’est d’arriver avec des solutions déjà toutes faites, sans tenir compte de la réalité des dynamiques locales. On plaque des modèles venus d’ailleurs, qu’on habille avec des mots comme “durable”, mais qui ne prennent pas racine localement. Une autre erreur, plus subtile, c’est de traiter les communautés comme des bénéficiaires passifs, au lieu de les considérer comme des acteurs à part entière.
À mon avis, un projet de développement qui n’est pas compris, porté et transformé par les gens eux-mêmes est déjà condamné.
Le développement durable en Afrique ne peut pas être théorique. Il doit partir de la vie réelle, du quotidien, de la parole des premiers concernés.
Quels sont les impacts les plus visibles du changement climatique sur les communautés rurales africaines ?
Ils sont nombreux : dans de plusieurs zones rurales, les terres s’assèchent, les saisons ne sont plus fiables, perte de biodiversité, à cela s’ajoute les déplacements forcés, l’insécurité alimentaire croissante, l’accès à l’eau qui devient un combat quotidien.
Mais au-delà des faits physiques, il y a les impacts humains : une augmentation des tensions sociales, une précarisation des minorités et surtout, un sentiment d’abandon qui grandit. Ce qu’on appelle “changement climatique”, eux le vivent comme un dérèglement de tout ce qui faisait sens : l’agriculture, la transmission, le lien à la terre. Et pour moi c’est vraiment là qu’on voit que la crise est à la fois écologique et sociale.
Comment les réalités locales peuvent-elles inspirer des politiques publiques plus adaptées aux enjeux environnementaux ?
Les réalités locales sont des “laboratoires” à ciel ouvert. Elles montrent ce qui marche, ce qui bloque, et surtout ce qui résiste. C’est une forme d’intelligence qu’on ne retrouve dans aucun rapport. Trop souvent, les politiques publiques sont conçues loin des réalités. Pourtant, les réponses les plus durables viennent du bas, pas du haut.
C’est en écoutant les producteurs, les femmes, les jeunes et les anciens… qu’on peut construire des politiques environnementales qui tiennent vraiment debout. Parce que ces acteurs eux, vivent les conséquences au quotidien. Ce qu’il faut, ce n’est pas seulement “consulter les communautés”, c’est intégrer leurs savoirs dans la construction des solutions.
Quelles solutions locales vous ont particulièrement marquées par leur efficacité ou leur originalité ?
Franchement, des solutions locales originales et efficaces, j’en ai vu beaucoup sur le terrain. Surtout dans les zones rurales, où les gens trouvent toujours un moyen de faire avec peu. Mais s’il y en a une qui m’a vraiment marquée, c’était dans le cadre du projet qu’on a réalisé au Ghana.
Au départ, on avait identifié le besoin le plus urgent avec l’ONG locale partenaire : l’accès à l’eau. Il faut noter que la zone choisie est très aride. Ainsi, on avait prévu d’installer un système de pompage solaire pour améliorer l’accès à l’eau de manière durable. Mais c’est en discutant avec les habitants, et surtout avec une coopérative de femmes très active, que le projet a pris une autre tournure.
Elles ont dit : “Oui, l’eau est vraiment essentielle. Mais si on pouvait utiliser cette eau aussi pour cultiver quelques légumes, ce serait une vraie révolution pour nous et nos enfants.” Et là, on a co-réfléchi. Elles ont évoqué l’idée d’un système d’irrigation. Et ensemble, on a adapté le projet pour y intégrer un système de goutte-à-goutte: simple, économe en eau, mais hyper efficace.
Ce qui m’a marquée, c’est que cette solution, on n’avait pas été anticipée. Elle est venue du terrain, des femmes elles-mêmes. Elles ont élargi notre regard. Et au final, nous avons répondu non seulement au problème de l’eau, mais aussi à celui de la nutrition, de la sécurité alimentaire et du développement économique local. Pour moi, cela représente l’une des plus belles définitions d’une solution locale réussie : une solution née de l’écoute, enrichie par l’intelligence collective, et qui répond à plusieurs besoins à la fois.
Comment les jeunes Africains peuvent-ils être mieux accompagnés pour devenir des acteurs du changement dans les domaines de l’agriculture et du climat ?
La première chose selon moi serait de sortir d’une posture »paternaliste ». Les jeunes Africains ne sont pas des pages blanches à remplir. Beaucoup ont déjà des idées concrètes, des projets enracinés dans leur réalité.
Ce qu’il manque souvent, ce n’est pas l’envie ou la créativité mais l’accès aux moyens: à la terre, au financement, au savoir, aux technologies. Je pense aussi qu’on confond trop souvent “sensibilisation” et “implication”.
Ce dont les jeunes ont besoin, ce n’est pas seulement d’être sensibilisés, c’est d’être outillés et écoutés. Et pour cela, il faudrait les intégrer aux espaces de décision, et leur faire véritablement confiance.
Enfin, je crois beaucoup aux dynamiques intergénérationnelles. On gagnerait à créer plus de ponts entre la sagesse des aînés et la créativité des plus jeunes. C’est de cette alliance que peuvent naître les solutions les plus durables.
Quel rôle les femmes jouent-elles dans la gestion de l’eau et la résilience agricole, et comment peut-on mieux les soutenir ?
“Investir dans une femme, c’est investir dans toute une génération.” Cette phrase de Kofi Annan résume tout. Sur une grande partie du continent, les femmes sont en première ligne : ce sont elles qui vont chercher l’eau, qui cultivent les champs, qui nourrissent les familles.
Elles sont les piliers silencieux de la résilience locale. Mais elles sont aussi celles qui ont le moins accès aux ressources : terre, crédit, savoirs techniques, représentation dans les instances décisionnelles. Et pourtant, elles innovent, elles tiennent, elles construisent.
Alors, si l’on veut renforcer la résilience agricole et climatique en Afrique, il faut investir sérieusement dans les femmes rurales: les reconnaître comme détentrices de savoirs pratiques et intergénérationnels (pas comme “groupes vulnérables”), sécuriser leur accès au foncier, leur fournir des outils adaptés, soutenir leurs initiatives collectives (souvent plus durables que les projets institutionnels), et surtout, les intégrer pleinement à la conception et à la gouvernance des projets.
Pensez-vous que les savoirs traditionnels africains sont suffisamment valorisés dans les stratégies climatiques actuelles ?
Non, pas vraiment. Les savoirs traditionnels africains restent largement ignorés dans les stratégies climatiques actuelles. Et pourtant, ce sont des savoirs profondément durables, adaptés aux écosystèmes locaux, testés sur plusieurs générations. Le problème, c’est qu’on continue à les voir comme “non scientifiques” ou “non modernes”.
Mais sur le terrain, ce sont souvent eux qui tiennent encore les communautés debout. Il ne s’agit pas de choisir entre technologie et tradition. Il s’agit de reconnaître que ces savoirs sont une richesse stratégique, qu’on doit protéger, documenter, et intégrer dans nos politiques si on veut réellement construire une résilience vraiment locale.
Comment concilier innovation technologique et respect des réalités locales dans les projets agricoles ?
Pour moi, tout commence par une chose simple: l’innovation ne doit jamais précéder le besoin. Trop souvent, on arrive avec des technologies pensées ailleurs, qui ne parlent pas aux réalités locales.
Une bonne technologie, ce n’est pas forcément la plus avancée, c’est celle qui est utile, maintenable localement, et socialement acceptée. L’idéal, c’est quand la technologie est co-développée avec les acteurs locaux, à partir de leur contexte, de leurs savoirs, de leurs contraintes.
Quels sont les freins majeurs à la mise en œuvre de solutions durables dans les zones rurales?
Je dirais que le tout premier frein, c’est de penser à la place des bénéficiaires. On arrive souvent avec des idées toutes faites, parfois très bonnes sur le papier, mais qui ne prennent pas du tout en compte les réalités du terrain. Cependant, dans les zones rurales, chaque contexte est spécifique : les besoins, les habitudes, les dynamiques communautaires… ne sont pas généralisables.
Ensuite, il y a des freins très concrets, comme le manque d’accès aux infrastructures de base.
Si on parle d’agriculture durable mais qu’il n’y a pas d’eau, pas d’électricité, pas de route… Il serait difficile de mettre quoi que ce soit en œuvre, même avec la meilleure volonté du monde.
Et puis, il y a aussi la question des finances. Beaucoup de projets restent bloqués parce que les dispositifs existants sont trop lourds, trop éloignés des réalités rurales. Les jeunes ou les groupements de femmes, par exemple, en depit de leurs idées quoique pertinentes, ne rentrent pas dans les cases classiques. Et donc passent à côté des opportunités.
Enfin, je pense qu’il ne faut pas sous-estimer le facteur humain : une solution, pour durer, doit être comprise, acceptée, appropriée. Et cela prend du temps, demande de la présence sur le terrain, de l’écoute, de la formation, du suivi.
Alors, pour moi, les freins sont là : dans le décalage entre les méthodes “externes” et la réalité des personnes concernées. Toutefois, je reste convaincue que si nous changeons notre posture et co-construisons avec les communautés, tout en leur faisant confiance, les solutions peuvent vraiment s’ancrer en durabilité.
Comment les récits et les histoires locales peuvent-ils contribuer à une meilleure compréhension des enjeux climatiques ?
Je pense qu’ils sont essentiels. Parce que les récits permettent de comprendre ce que les chiffres ne disent pas. Bien souvent, lorsqu’ on parle climat, on parle en chiffres, en tonnes de CO2, en degrés…
Mais quand un paysan vous explique comment la sécheresse a bouleversé son quotidien, vous comprennez véritablement ce qu’est le changement climatique. Pas juste en théorie, mais dans la vie réelle. Les histoires locales traduisent l’impact humain des crises. Et cela change tout: cela touche, mobilise, et surtout permet d’agir avec plus de justesse.
Et puis les récits sont aussi un outil de transmission. En Afrique, la parole a toujours été un pilier : les contes, les proverbes, les témoignages… Ce sont des formes de savoir qui portent des leçons très puissantes, y compris sur l’environnement. Donc valoriser ces histoires, c’est aussi redonner sa place aux savoirs endogènes, à l’expérience vécue, et sortir d’une vision uniquement technocratique du climat.
Chaque histoire locale est une brique pour construire une conscience collective. Et c’est cette conscience qui, au final, peut faire bouger les choses.
Aujourd’hui, on a besoin d’ingénieurs du climat, oui, mais on a aussi besoin de ceux qui savent raconter le vécu des populations, pour qu’on arrête (enfin) de construire des politiques déconnectées.
Quel lien établissez-vous entre justice climatique et justice sociale dans le contexte africain ?
Ils sont indissociables. On ne peut pas parler de climat sans parler de justice sociale. En Afrique, ce sont souvent les communautés les plus marginalisées qui subissent le plus les effets du dérèglement climatique. Et ce sont aussi celles qui ont le moins accès aux ressources pour s’en protéger. Cette double vulnérabilité révèle une chose essentielle : le climat ne fait qu’amplifier des inégalités sociales déjà existantes. C’est pour cette raison que l’on ne peut pas penser la justice climatique sans la justice sociale.
Si on aborde le climat uniquement par des indicateurs environnementaux, on passe à côté de l’essentiel. Ce qu’il faut, c’est une approche qui intègre les droits sociaux, les enjeux de pouvoir, et la question de qui a vraiment accès aux ressources.
Sinon, on risque de produire des solutions qui aggravent les déséquilibres au lieu de les corriger. La transition climatique en Afrique doit aussi être une transition sociale. S’il n’y a pas de justice sociale, il n’y aura pas de justice climatique. Et inversement.
Quels types de cooperations sont nécessaires pour renforcer les initiatives locales sans les dénaturer ?
Des partenariats basés sur l’écoute, l’équité, la co-construction. Renforcer une initiative locale, ce n’est pas arriver avec des solutions toutes faites, c’est travailler avec les communautés comme avec de vrais partenaires, pas comme avec des exécutants. Çela signifie : co-construire dès le départ, adapter les outils au contexte, et surtout laisser les communautés piloter leurs propres projets.
Une bonne collaboration, c’est aussi un rapport d’égal à égal : chacun apporte quelque chose, les ressources d’un côté, les savoirs, la légitimité et l’ancrage de l’autre. C’est cette complémentarité qui garantit que l’initiative reste fidèle à ce qu’elle est, et qu’elle dure.
Un dernier mot?
L’ Afrique n’est pas un continent à sauver. C’est un continent à écouter. Elle porte en elle les clés de sa propre transformation. Et si on prend le temps d’entendre ses voix, de soutenir ce qui émerge de l’intérieur, et de croire vraiment en sa jeunesse, en ses femmes, en ses territoires…alors oui, cette Afrique qu’on veut tous naîtra.

Le paradoxe africain celui d’un continent exceptionnellement riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis structurels persistants appelle une réponse audacieuse, contextualisée et profondément ancrée dans les réalités locales. Terres fertiles, diversité écologique, abondance minérale et hydrique : autant d’atouts qui, paradoxalement, coexistent avec une précarité alimentaire chronique, un accès limité à l’eau potable et une faible couverture énergétique.
Face à cette contradiction, une interrogation stratégique s’impose : où se situe la solution aux défis liés à l’eau, à l’énergie et à l’agriculture ?
La réponse se trouve en grande partie sur le continent lui-même. Elle repose sur la mise en œuvre de modèles adaptés aux contextes locaux, tels que l’agroécologie ou l’irrigation solaire ; sur des politiques publiques inclusives, mobilisant l’ensemble des acteurs des chaînes de valeur ; sur une implication active des jeunes et des femmes dans les processus décisionnels ; et sur le développement d’innovations territorialisées, à l’image d’Agricarbone Plus en Côte d’Ivoire, SunCulture au Kenya ou Zenvus au Nigeria.
À cela s’ajoute l’impératif de renforcer les capacités locales et de promouvoir un financement climatique équitable, fondé sur les principes de justice, de solidarité et de responsabilité partagée. La clé réside dans la valorisation stratégique des ressources internes, la mobilisation des savoirs endogènes et le renforcement des dynamiques communautaires, qui constituent les fondements d’une réponse africaine durable, résiliente et souveraine aux défis systémiques du XXIe siècle.
Cher Louise, InspireAndShine vous remercie pour votre contribution à cette analyse.
Comme elle, vous pouvez vous aussi partager votre expertise sur des sujets au cœur de la transformation sociale en Afrique. Pour cela, envoyez-nous votre biographie à l’adresse suivante : contact@iinspireandshine.com.
Sources :
1- https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1507024/
2- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388952_fre
3- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380733_fre
Raissa KOUADIO
Pour tout savoir sur votre blog: Tout savoir sur InspireAndShine – InspireAndShine
A lire aussi en Octobre sur InspireAndShine !
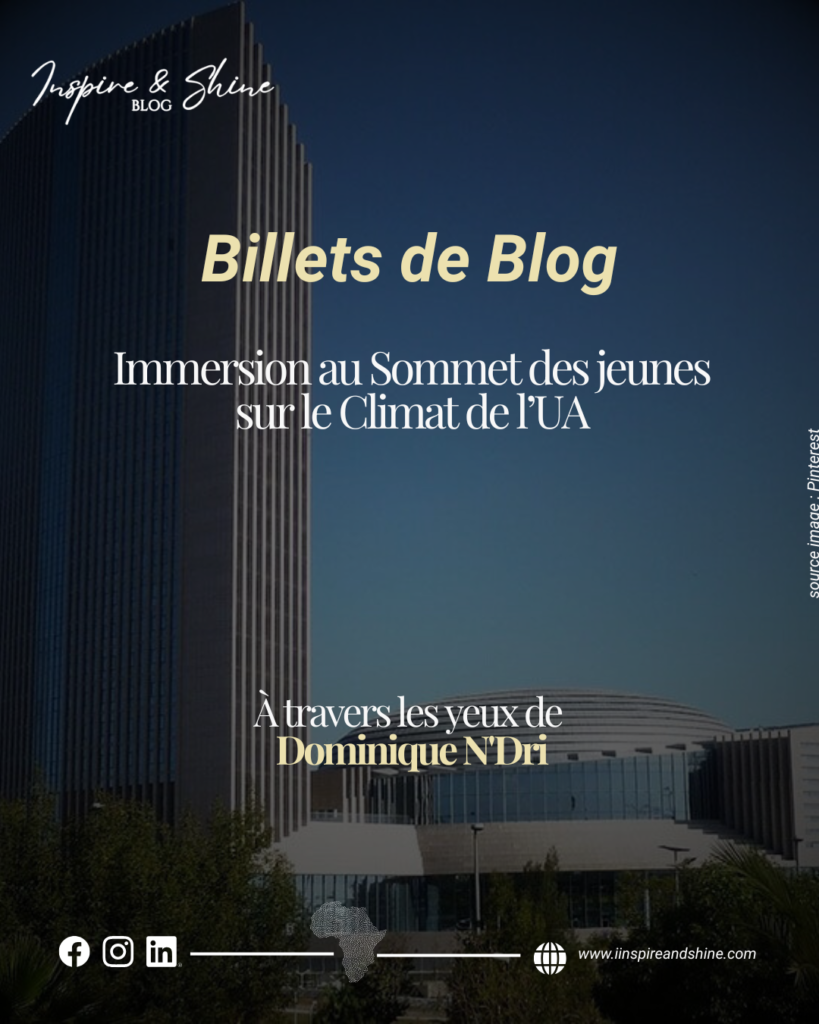

Votre blogueuse

En créant ce blog, je ne savais pas que j’avais entre mes mains un véritable outil de plaidoyer en faveur du changement et du développement du continent africain. J’espère que vous avez aimé ce contenu et que vous êtes désormais parmi les fidèles lecteurs. N’oubliez pas de vous abonner au blog et de nous suivre sur LinkedIn et Facebook.