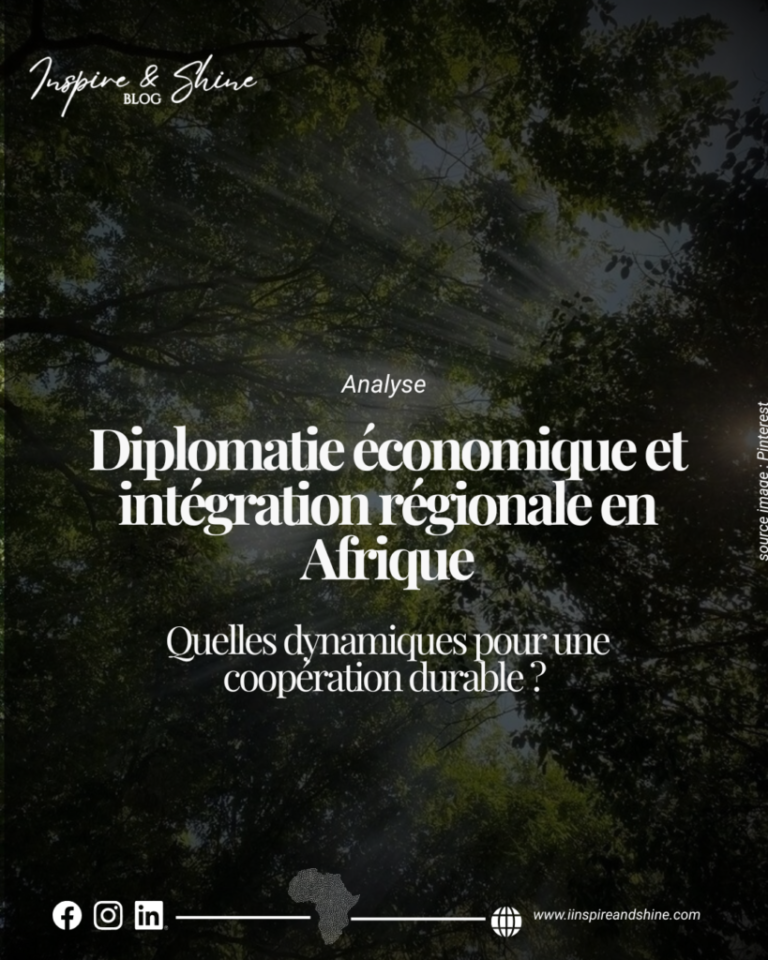Repenser les modèles territoriaux pour une durabilité inclusive et résiliente
Analyse avec Bocar Harouna DIALLO
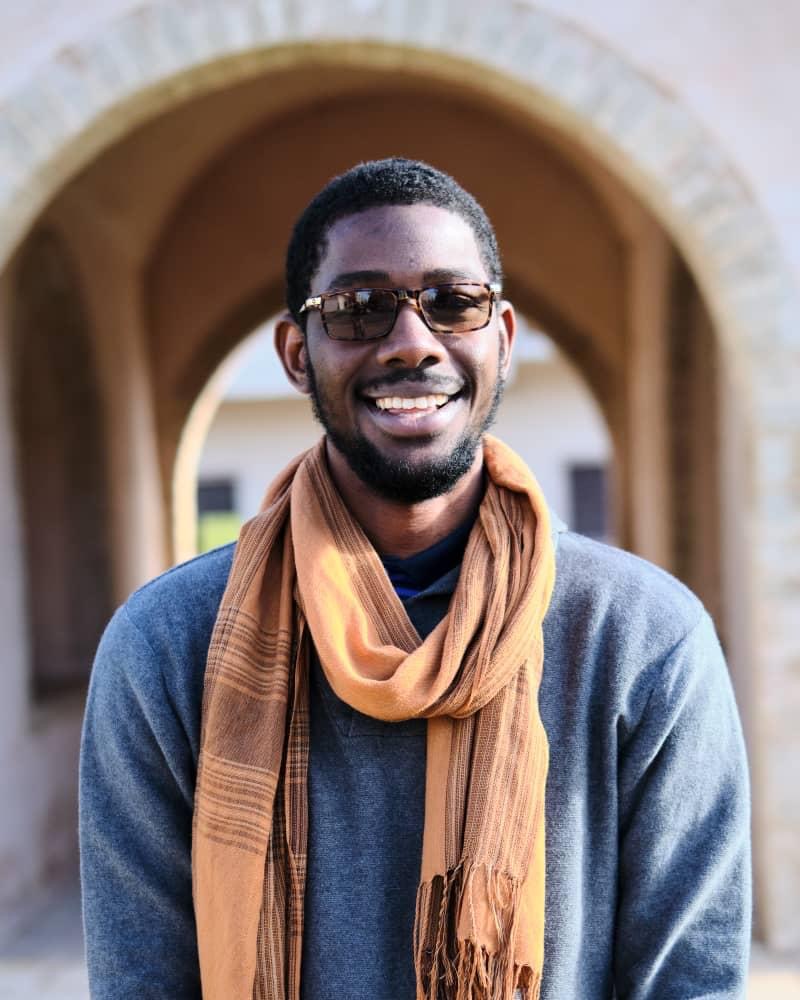
Dans un contexte africain en pleine transformation, marqué par des défis écologiques, sociaux et économiques de plus en plus complexes, la transition socio-écologique s’impose comme une priorité stratégique pour repenser les trajectoires de développement du continent. Elle offre l’opportunité de dépasser les modèles hérités de la période coloniale pour construire des alternatives endogènes, inclusives et résilientes, en phase avec les réalités locales. Repenser les modèles territoriaux dans cette dynamique, c’est promouvoir une gouvernance participative, valoriser les savoirs traditionnels en synergie avec les innovations technologiques, et renforcer la capacité des territoires à faire face aux crises. Cette approche vise à bâtir des espaces durables, cohérents et solidaires, où les collectivités locales jouent un rôle central, soutenues par des mécanismes financiers innovants et des partenariats multi-acteurs.
Cette semaine, dans la rubrique Analyse, nous mettons en lumière le thème :
« Transition socio-écologique en Afrique : repenser les modèles territoriaux pour une durabilité inclusive et résiliente ».
Pour enrichir cette réflexion, nous accueillons un contributeur engagé, originaire du Sénégal.
Son nom : Bocar Harouna DIALLO.
Analyse
Cher invité, bienvenue sur InspireAndShine, avant tout propos qui est Bocar Harouna DIALLO?
Bocar Harouna DIALLO est géographe rural, titulaire d’une licence en géographie humaine, spécialisé dans l’espace, les sociétés et le développement, et d’un master en gestion et développement des zones rurales (GDER) de l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar.
Ma carrière professionnelle reflète un engagement profond en faveur du développement. Actuellement doctorant en développement régional et territorial à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), je combine l’expertise académique acquise dans plusieurs universités canadiennes et sénégalaises avec l’expérience pratique acquise dans des centres de recherche, des laboratoires et des organisations internationales, tant au niveau national (Sénégal) qu’international, sur des thèmes liés au développement local, à l’environnement, à l’agriculture et à la transition socio-écologique. Ce parcours est renforcé par plusieurs certifications en développement durable, gestion et management de projet, en durabilité et éthique.
Que vous inspire le thème sujet à notre analyse ? En quoi la transition socio écologique représente-t-elle une opportunité stratégique pour repenser les trajectoires de développement en Afrique ?
Le thème de la transition socio-écologique en Afrique représente un paradigme fondamental pour repenser véritablement le développement continental. Cette transition constitue une opportunité sans précédent de transcender les modèles de développement hérités de la période coloniale sinon postcoloniale. Elle permet ainsi d’envisager des trajectoires de développement endogènes, adaptées aux réalités écologiques et socioculturelles africaines.
Quels sont, selon vous, les éléments constitutifs d’un modèle territorial africain durable, inclusif et résilient ?
Pour concevoir un modèle territorial africain viable, inclusif et résilient, plusieurs éléments fondamentaux sont à prendre en ligne de compte.
La décentralisation effective des pouvoirs, associée à une gouvernance participative, constitue le fondement institutionnel essentiel, dans la mesure où elle permet l’implication active des communautés locales dans les processus décisionnels. Et le Sénégal a fait un grand bon en avant à travers son acte III de la décentralisation. De plus, l’intégration harmonieuse des connaissances traditionnelles et des innovations technologiques adaptées au contexte local optimise la gestion des ressources naturelles tout en préservant le patrimoine culturel. Par ailleurs, la diversification économique fondée sur les potentiels territoriaux spécifiques, associée à des mécanismes de redistribution équitable des richesses, favorise sans aucun doute la résilience face aux chocs extérieurs. Enfin, un réseau territorial équilibré entre zones rurales et urbaines, soutenu par des infrastructures vertes et résilientes, assure une cohésion spatiale durable. C’est le modèle parfait du Maroc vert et le PSE du Sénégal.
Comment les politiques de développement peuvent-elles mieux intégrer les Spécificités écologiques, sociales et culturelles des territoires africains ?
Les politiques de développement en Afrique nécessitent une approche systémique qui intègre trois dimensions essentielles : (1) l’adaptation aux écosystèmes locaux et leur résilience au changement climatique, (2) la reconnaissance des structures sociales traditionnelles dans la gouvernance, et (3) la promotion des connaissances endogènes. Une telle approche permettrait d’optimiser l’efficacité des interventions et de préserver le capital social et environnemental des territoires africains. C’est approche est testée dans plusieurs pays dont le Sénégal et le Maroc à travers des programmes verts.
Quels leviers institutionnels et financiers sont nécessaires pour accélérer la transition socio-écologique à l’échelle locale ?
La mise en œuvre efficace de la transition socio-écologique locale demande à la fois une décentralisation efficace et harmonisée et des mécanismes financiers surtout novateurs. Dans ce cas, le défi est quasi double : renforcer l’autonomie décisionnelle des autorités locales tout en garantissant leur capacité d’action grâce à des instruments financiers adaptés (fonds dédiés, fiscalité verte). La réussite dépend dans ce d’une coordination, d’une synergie d’actions à plusieurs niveaux et d’un soutien technique à long terme aux acteurs locaux. Cela facilite l’interaction bottum-up et top-down.
Comment articuler les innovations technologiques dans la construction de modèles territoriaux durables ?
L’intégration des innovations technologiques dans la construction de modèles territoriaux durables en Afrique traduit une transformation majeure du développement territorial, comme en témoignent plusieurs initiatives innovantes à travers le continent.
Du Rwanda au Nigeria, en passant par le Kenya, l’Égypte, le Maroc et l’Afrique du Sud, les innovations technologiques révolutionnent divers secteurs : des soins de santé avec les drones médicaux à l’inclusion financière avec M-Pesa, en passant par la gestion urbaine intelligente et l’agriculture numérique.
Au Sénégal, cette dynamique est particulièrement évidente dans le projet « Smart City » de Diamniadio, qui intègre des solutions numériques pour la gestion urbaine. Il y’a également le mega projet du New deal technologique.
En fin de compte, ces exemples montrent comment l’Afrique, y compris le Sénégal, adopte des solutions technologiques innovantes pour construire des territoires plus durables et plus résilients, alliant développement social, efficacité économique et protection de l’environnement. Ces initiatives contribuent à une transformation numérique inclusive qui répond aux besoins des africaines.
Quels rôles les collectivités territoriales peuvent-elles jouer dans la mise en œuvre de stratégies de résilience face aux crises climatiques ?
Les autorités locales jouent un rôle fondamental dans la résilience climatique à travers trois domaines principaux :
- Planification qui consiste à faire: Documents d’urbanisme ; Plans climatiques ; Aménagement du territoire.
- Action directe autrement dit : Rénovation énergétique ; Gestion des ressources disponibles ; Infrastructures durables.
- Coordination locale qui met l’accent sur: la sensibilisation du public; le soutien aux acteurs locaux ; la coordination des initiatives.
Leur positionnement en tant qu’acteurs locaux leur permet d’adapter les stratégies aux réalités locales et de mobiliser efficacement l’ensemble des acteurs de la région.
Comment renforcer la gouvernance territoriale pour garantir une participation équitable des populations vulnérables ?
Dans le contexte actuel africain de transformation sociale, l’inclusion des populations vulnérables dans la gouvernance territoriale suppose une approche à la fois cohérente et systématique. D’une part, les autorités locales sont appelées à mettre en place des mécanismes institutionnels solides, tels que des organes consultatifs dédiés et des budgets participatifs. D’autre part, ces mécanismes sont accompagnés par des médiateurs territoriaux qui facilitent le dialogue entre les institutions et les citoyens.
Par ailleurs, l’accessibilité est une question fondamentale pour garantir une participation effective. Cela implique notamment d’adapter la communication aux différents publics. De plus, la mise à disposition de supports inclusifs permet à chacun de comprendre et de contribuer aux débats. Enfin, le soutien est le troisième pilier essentiel de cette approche. D’une part, cela se traduit par une formation aux processus démocratiques et un soutien aux organisations communautaires. D’autre part, un suivi rigoureux des résultats permet d’évaluer l’impact réel des mesures mises en place. Par conséquent, cette approche globale garantit que les voix des populations vulnérables sont non seulement entendues, mais aussi effectivement prises en compte dans les décisions au niveau territorial.
Quels sont les risques d’une transition socio-écologique mal planifiée ou trop centralisée dans le contexte africain ?
Les risques liés à une transition socio-écologique mal planifiée ou trop centralisée en Afrique peuvent être classés en trois grandes catégories :
1. Risques sociaux : Aggravation des inégalités existantes ; Déplacement forcé des populations rurales; Perte des savoirs traditionnels ; Insécurité énergétique accrue; Tensions communautaires ;
2. Risques économiques : Dépendance accrue vis-à-vis des technologies exogènes ; Endettement public excessif ; Affaiblissement des économies locales; Destruction d’emplois informels locaux ; Accaparement des ressources par les élites;
3. Risques écologiques et territoriaux : Solutions inadaptées aux contextes locaux surtout dans un contexte de changement climatique ; Dégradation des écosystèmes traditionnels ; Conflits liés à l’utilisation abusive des ressources ; Urbanisation incontrôlée ; Perturbation des systèmes agricoles locaux.
Pour éviter ces risques, la transition doit s’appuyer sur les dynamiques locales tout en intégrant les connaissances traditionnelles, privilégier les solutions décentralisées qui garantissent la participation des communautés et assurer une répartition équitable des bénéfices. Cela permet une gestion des biens communs plus harmonisée.
Comment mesurer l’impact réel des politiques de transition sur la qualité de vie des Populations locales ?
L’évaluation de l’impact des politiques de transition sur la qualité de vie des populations locales requiert une méthodologie rigoureuse combinant plusieurs dimensions. Des indicateurs socio-économiques et environnementaux constituent la base de cette analyse, tandis que des méthodes participatives garantissent une compréhension approfondie des changements observés. Cette approche systémique, associée à un processus transparent de collecte de données auprès de la population, permet de comprendre les différents effets selon les territoires et les groupes sociaux, dépassant ainsi les simples mesures standardisées pour saisir la complexité des transformations en œuvre.
Quels types de partenariats (publics, privés, communautaires) sont les plus efficaces pour soutenir les dynamiques territoriales durables ?
Les partenariats les plus fructueux pour soutenir une logique territoriale viable se fondent sur trois configurations principales : les partenariats public-privé-communautaire (PPPC), qui combinent les capacités institutionnelles, l’expertise technique et la légitimité sociale ; les partenariats public-communautaire, qui privilégient l’appropriation locale des projets d’intérêt général ; et les partenariats privé-communautaire, qui favorisent l’innovation sociale. Leur réussite dépend essentiellement d’une gouvernance équilibrée, d’une répartition claire des responsabilités et d’un suivi rigoureux des résultats.
Les territoires devraient-ils devenir des espaces d’expérimentation pour des modèles économiques alternatifs (agroécologie, économie circulaire, etc.)?
L’expérimentation de modèles économiques alternatifs dans les régions africaines pourrait offrir un potentiel important, notamment grâce à leur tradition de pratiques durables et à leur capacité d’innovation et résilience. Cependant, cette approche doit être soumise à des conditions strictes telles que la gestion locale, respect des spécificités régionales et partage équitable des bénéfices. L’objectif n’est pas de transformer ces régions en simples terrains d’expérimentation, mais plutôt de développer des solutions sur mesure qui servent véritablement les intérêts des communautés locales, en puisant dans leurs connaissances traditionnelles et leurs aspirations en matière de développement durable.
Quel est, selon vous, le rôle des institutions régionales africaines dans l’harmonisation des politiques de transition territoriale ?
Les institutions régionales africaines jouent un rôle moteur dans l’harmonisation des politiques de transition territoriale à travers le continent. Ces organisations, telles que la CEDEAO, l’Union africaine, la SADC et le NEPAD, agissent comme catalyseurs pour un développement territorial coordonné. Leur action se manifeste surtout par la mise en place de cadres réglementaires communs et le financement de projets structurels africains. Par exemple, le corridor Abidjan-Lagos est une parfaite illustration de cette coordination régionale, impliquant cinq pays d’Afrique de l’Ouest à travers des infrastructures partagées. La grande muraille verte depuis 2009 est un exemple patent. La gestion transfrontalière des ressources naturelles, comme dans le cas du parc transfrontalier du Grand Limpopo, démontre également l’efficacité de cette approche régionale. En plus, ces institutions contribuent également au renforcement des capacités locales et à la diffusion des bonnes pratiques en matière de gouvernance territoriale. L’Initiative pour la politique foncière de l’Union africaine guide les réformes nationales, tandis que les programmes de formation du NEPAD soutiennent la décentralisation et des investissements majeur sur le volet environnement.
Comment intégrer les enjeux de justice sociale et de redistribution dans les stratégies de durabilité territoriale ?
L’intégration de la justice sociale et de la redistribution dans les stratégies de durabilité territoriale en Afrique est évidente dans un certain nombre d’initiatives innovantes et prometteuses. Par exemple, le Rwanda se distingue par son programme « Vision 2020 Umurenge », qui combine protection sociale et développement durable afin de créer une synergie entre les besoins sociaux et environnementaux. De plus, le Sénégal, à travers son Programme national de filet de sécurité familiale, illustre parfaitement comment les transferts monétaires peuvent être associés à une formation en agriculture durable. Par ailleurs, l’Éthiopie démontre, à travers son programme Productive Safety Net, qu’il est possible de concilier protection sociale et résilience environnementale. De même, l’Initiative nationale pour le développement humain du Maroc démontre l’importance d’une approche intégrée du développement territorial. Concernant la création d’emplois, elle peut aller de pair aussi avec la protection de l’environnement. Enfin, le Kenya, à travers M-KOPA, montre comment l’innovation technologique peut servir à la fois l’inclusion sociale et la transition écologique. Finalement, ces différentes initiatives démontrent que l’Afrique développe des approches innovantes pour combiner justice sociale et durabilité environnementale. Ces expériences réussies soulignent l’importance d’une vision holistique du développement africain
Un dernier mot ?
Je tiens à vous remercier pour m’avoir permis d’échanger sur ce sujet qui est aujourd’hui une préoccupation régionale. Et je vous encourage pour votre remarquable travail.

La transition socio-écologique en Afrique ne saurait être une simple adaptation technique aux enjeux environnementaux. Elle incarne une transformation profonde des modèles territoriaux, appelant à une gouvernance décentralisée, inclusive et enracinée dans les réalités locales. Les propos de Bocar Harouna DIALLO nous rappellent une évidence : sans implication des communautés, sans valorisation des savoirs traditionnels et sans justice territoriale, les ambitions de durabilité resteront fragiles et inégalement partagées.
Dans un continent en pleine mutation, où les crises climatiques croisent les aspirations sociales, l’urgence est de bâtir des territoires résilients, porteurs d’innovation et de dignité. Cette transition ne peut réussir sans une mobilisation collective, des collectivités locales aux institutions régionales, en passant par les acteurs privés et la société civile. Faire de la durabilité territoriale une priorité, c’est investir dans un avenir africain plus juste, plus solidaire et plus souverain.
Cher Bocar, InspireAndShine vous remercie chaleureusement pour votre précieuse contribution à cette analyse. À travers votre regard de géographe ruraliste et votre engagement pour un développement territorial juste et durable, vous avez su éclairer les enjeux complexes de la transition socio-écologique en Afrique. Vos propos nous rappellent que les territoires africains ne sont pas de simples espaces à aménager, mais des lieux vivants, porteurs de savoirs, de résilience et d’innovation. En valorisant les dynamiques locales, les institutions inclusives et les partenariats audacieux, vous participez activement à la construction d’un avenir africain plus équitable et plus souverain.
Comme Bocar, vous aussi pouvez partager votre expertise sur des sujets au cœur de la transformation sociale et écologique en Afrique. Pour cela, envoyez-nous votre biographie à l’adresse suivante : contact@iinspireandshine.com.
Bocar Harouna DIALLO: boxdiallo@hotmail.fr; bhdiallo@etu.uqac.ca
InspireAndShine
Pour tout savoir sur votre blog: Tout savoir sur InspireAndShine – InspireAndShine
A lire en Prochainement sur InspireAndShine !